Édito poétique. « J’écris des livres anti-patates : la patate y est contenue », écrit Nathalie Quintane dans Tomates (P.O.L, 2010 ; rééd. 2022). La poésie serait-elle patate ou anti-patate ? Lieu d’un engagement par l’écriture (considérée comme intrinsèquement subversive, indépendamment de son contenu) ou d’un engagement en écriture (transfert direct du politique dans le poème-tract) ?
Je tourne et retourne autour de cette question de la radicalité dans l’écriture depuis plusieurs mois et une réponse est venue de l’écrivaine et critique Rachel Lamoureux [1] sur les réseaux :
« Je nous souhaite des socioécritures, qui dépassent de loin l’idée du poème, je nous souhaite des textualités libérées de la finalité de l’objet littéraire, de l’œuvre, des textualités comme tensions sociales (relationnelles), qui nous rapprochent et nous repoussent ensemble, nous maintiennent, par l’entremise de collaborations institutionnelles alternatives induites par chacun, dans des rapports tendus toujours à renégocier, sans quoi c’est long longtemps, la littérature, dans sa fausse conscience tranquille d’aménager du lien, car moi, ce que je vois (souvent et beaucoup), ce sont des liens tissés selon une logique esseulante, l’écriture comme inscription qui ne s’inscrit dans rien. » [2]
Socioécritures. Voilà une notion qui fait trembler l’analyse critique sur ses fondations ! À la « logique esseulante » d’une « belle langue », la poétesse Séverine Daucourt répond : « La poésie qui ne dérange pas est autre chose que de la poésie. » [3]
Souhaitons-nous, nous aussi, des socioécritures.

Sous-titré « Petit précis de psychiatrie poétique », le livre de Séverine Daucourt est un dispositif à trois voix : celle de la folle, celle de la poétesse (l’autrice préfère le terme de poète) et celle de l’institution médicale. Séverine Daucourt a réécrit son texte, sur les conseils de son éditrice [3], en y réintroduisant une part autobiographique qui structure l’ensemble et donne véritablement corps à ce trio de voix.
Voix écrites ou écriture pour la voix, ce qui se joue dans cette fascinante partition ce sont les rapports en tension entre la parole, y compris la parole tue (« je suis ce que je tais » p. 31), et l’écrit, — les béances du langage : « les regards, je me les remets vite dans la bouche », écrit la poétesse (page 10).
Ce qui importe ici c’est d’où le texte est écrit, ce qui nous permet de déterminer où porte la voix. Car Les Éperdu(e)s traite du vide, non pas comme le résultat d’une soustraction, mais comme une véritable somme : les trois voix poussent le langage hors du territoire de ses propres assignations : « LE POÈME EST LE NOM DE LA FOLIE DANS LE LANGAGE. » (p. 89)
Composé dans ce hors-champ du langage, dans l’angle mort de la raison raisonnante, Les Éperdu(e)s est le livre d’une autrice qui a appris à désécrire. Son dispositif textuel (sa partition) est moins une construction qu’une déconstruction qui produit des effets contrapuntiques saisissants.
L’art poétique de Séverine Daucourt transparaît dans cette recherche de production de sens par surimpression, chaque bloc textuel se présentant à nous dans une graphie qui lui est propre, sans pour autant jouer de l’exclusion, bien au contraire.
Le sur-texte brouille la lecture analytique qui entend séparer raison et déraison, l’institution et la folle. « Écrire sauve. Je peux m’y réfugier et y désigner le froid, le temps perdu, le futur antérieur », écrit la poétesse (p. 28). À l’exclusion institutionnelle du je désigné comme autre, Séverine Daucourt répond par l’inclusion du nous : son écriture poétique devient littéralement inclusive : « ils et elles, et moi avec, partons en quête d’un soi non colonisable » (p. 89).

JERK, second opus poétique de Maud Joiret, est un livre qui sonne en stéréo, un DJ set, une poésie pour platines. Avec son écriture tour à tour saturée et désaturée, son mix narratif ultra maîtrisé, le livre rugit derrière son titre majusculeux, qui est autant une injonction qu’une insulte, et sa stupéfiante photo de couverture signée Alice Khol, — pochette iconique pour ce livre-album placé sous le signe (al)léchant de la langue, donc.
« une femme
de profil aux lèvres
entrouvertes
le rouge brille
vasculaire il ébrase deux virgules
bombées imposant
la symétrie duckface
en miroir » (pp. 14-15)
JERK est l’un de ces rares livres qui parviennent à opérer un mouvement de bascule chez les lecteur·ices, à retourner comme un gant l’expérience supposément confortable de lecture, de telle sorte que ce soit le livre qui nous lise et non l’inverse : JERK nous lit à tous les degrés, sans ménagement, dans toutes les positions.
« […] le vent s’est fait la malle
emportant didascalies
personne aux lumières
et confiscation des ralentis
a
Le cinéma est la vie antérieure de nos embarras. » (p. 16)
JERK ne tend pas un miroir, ne reflète rien, ne réfléchit pas : il nous tend sa langue et un rythme ivre qui se déconstruisent mutuellement dans l’éblouissement d’une nuit trans-figurée du langage.
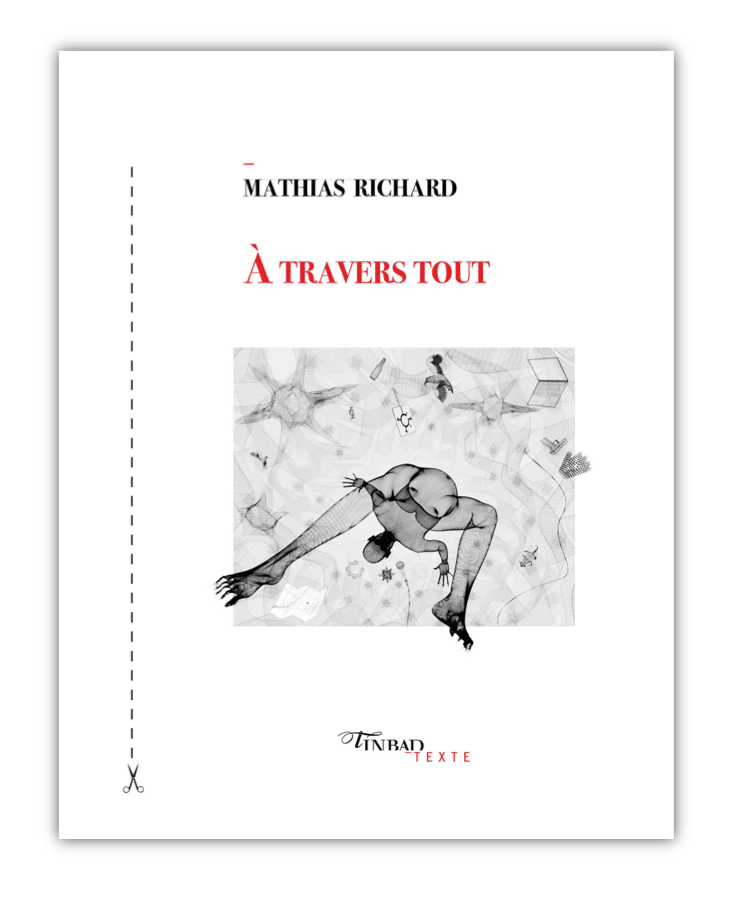
Livre crée à Marseille de 2014 à 2019, autant si ne c’est plus qu’écrit, tenu par son auteur-créateur comme son grand œuvre en poésie, À travers tout représente une impressionnante somme poétique dans laquelle les lecteur·ices trouveront à la fois des syntextes, des prenssées, des mots-pivots, de la Poetry Body Music, des équations de pensée, des textes de liste, des textes pour la performance et des chansons [4].
« On est forcé d’agir à l’intérieur d’une personne. | La tête est libre de droits. | je suis piraté donc je suis | compressez les codes militaires extraterrestres | Le corps, comme une pieuvre, absorbe tout ce qu’il rencontre. » (p. 58)
Plusieurs textes d’À travers tout ont été conçus avec la voix, avec des micros et des appareils enregistreurs et sont destinés à la lecture-performance. Mathias Richard évoque d’ailleurs à plusieurs reprises, en annexe, la différence entre les textes « pour la voix » et ceux « pour la tête » : « Dans une même langue, la plus grande différence qu’il puisse y avoir entre un texte et un autre est si ce texte est créé physiquement avec la voix, pour la voix, ou intérieurement, mentalement, avec la main, l’œil, pour la lecture intérieure, silencieuse. » (p. 406)
L’œuvre impressionne par sa maturité, sa maîtrise dans la démesure et par cette langue poétique de synthèse, aussi réjouissante qu’inquiétante, oscillant entre idiotie artificielle et folie visionnaire, slogan délirant et message automatisé d’erreur.
« Une erreur s’est produite avec le réel. Veillez réessayer. » (p. 110)
Se plonger dans ce livre magistral et fou revient à traverser une multiplicité de formes poétiques, parfois radicales, mais aussi plusieurs états, pensées et sentiments, à vivre une expérience de lecture intense et absolument unique. Un savoureux reboot du langage poétique.

Tutu c’est le livre qui est là alors que personne ne l’attend. Le livre que personne n’attend parce que personne ne peut écrire un livre tel que Tutu. Tutu c’est un livre écrit avec les deux cents mots de vocabulaire d’un manuel scolaire pour apprendre à lire au CP. Sauf qu’avec seulement deux cents mots de vocabulaire, Jean-Daniel Botta a composé autant de poèmes dont l’inventivité dépasse de loin tout ce que l’on peut lire dans les œuvres poétiques complètes d’éminents gendelettres. De cette inventivité naïve et sans limite des enfants qui pendant le temps du jeu font de leurs doigts un pistolet et de leur démarche sautillante une course à cheval.
« En enfance on porte dix fois son poids en air
comme un cosmonaute
un cosmonaute d’arbre. » (p. 51)
Dans l’espace infiniment fini du poème, tout redevient possible pour Jean-Daniel Botta qui utilise ici tous les outils du langage à sa portée pour jouer avec eux. Nulle hiérarchie sémantique ici, plutôt des contre-propositions insubordonnées et des compléments peu circonstanciés.
« Entre la bouche et le lointain
c’est un endroit pour un certain temps.
Par la bouche entrouverte de ma grand-mère
je vois les arbres qui arrivent. Elle dit
Sombrer n’a pas commencé avec toi.
Dans sa bouche il y a un lointain choisi par les chiens.
Ma grand-mère boit à reculons jusqu’aux arbres.
La mort il s’agit du choc de la bouche et du lointain
d’arbres qui traversent une belle zone de respiration.
Ma grand-mère boit à reculons jusqu’à son squelette
avant que les côtes
et le pied le plus important de la marelle
ne s’assèchent. » (p. 13-14)
Nous pouvons lire Tutu avec des yeux émerveillés d’enfant, de poète, de poétesse, de lecteur·ice. Nous pouvons lire Tutu pour ce qu’il est tout simplement : un chef-d’œuvre.

Des cinq livres mis en avant dans cet épisode de Contre-mesures, Et les regarder les fantômes est probablement celui dont la trajectoire dans le ciel médiatique est la plus furtive. Pourtant ce petit livre de quarante-huit pages renferme une écriture d’une densité extrême absolument remarquable. Le geste d’écriture est d’une force toute contenue.
« (Et) Pas se retourner. J’ai — En apparence. Pas se retourner. J’ai — Il y a longtemps. » [5]
Nous lisons sur la page l’amorce et devinons la trajectoire. La contraction de la langue, souvent à la limite de la rupture syntaxique, décuple la force de l’écriture. Rien ne se déploie. Tout se contracte. Et tout l’art de l’autrice est de parvenir à donner vie à son texte avec parfois seulement quatre mots : « (Et) Hier, ma nuit. » [5]
La poétesse travaille le matériau du langage comme une matière vivante, au niveau infra, jusque dans les interstices, l’infiniment petit du langage, ce qui est invisible à l’œil nu.
« Allegro. Maestoso.
(Et) Sans détour. Tout a. Tout, sauf ce qui était là, dans la poche intérieure, derrière la couture arrachée un soir de fête. Ce qui était là n’était plus dit, mais ça existait encore dans le présent. (Je) rêvais des nuits sans sommeil où nous vivions dans l’empressement du monde. La peau. Effleurée. À peine. Mains qui redessinaient les os. Entre les accrocs, là, sous le fil, on sentait le passage de l’aiguille, des doigts sur le tissu. Comme une ampoule pour que ça coule et que ça sèche — Enterré depuis — Griffures sur les bras. (Je) rêvais des ombres dans la nuit. À croquer dans les noyaux. Sentir dans la gueule les morceaux de nous. Dents trouées et fondues. » [5]
Poème symphonique minimaliste, Et les regarder les fantômes travaille les micro-intervalles dans la matière textuelle brute, ce qui écarte du sens et du son, et permet de regarder et d’entendre ce qui se produit dans ces interstices sourds et aveugles de la partition, sens et son dissociés, recomposés poétiquement et prosodiquement par la poétesse avec maestria.
Séverine Daucourt, Les Éperdu(e)s, éditions LansKine, octobre 2022
Maud Joiret, JERK, coll. Les deux sœurs, éditions L’arbre de Diane, octobre 2022
Mathias Richard, À travers tout, éditions Tinbad, septembre 2022
Jean-Daniel Botta, Tutu, coll. V20, éditions Vanloo, août 2022
Pauline Catherinot, Et les regarder les fantômes, coll. Sur le billot, éditions la Boucherie littéraire, septembre 2022
[1] https://rachellamoureux.ca/
[2] Rachel Lamoureux, facebook, 4 janvier 2023, https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid012dFowWEuhgejzpBqQaczq1LKwtUkgxTaHJygjPXUHB3Cc559vVJtjFQyCW1k8VPl&id=1362321148&mibextid=ykz3hl
[3] Entretien avec Séverine Daucourt par Johan Faerber publié dans Diacritik : https://diacritik.com/2022/11/21/severine-daucourt-mes-activites-de-poete-et-de-clinicienne-sentrecroisent-se-nourrissent-se-repondent-les-eperdues/
[4] Les syntextes sont des textes synthétiques ; les prensées des « pensées pressées » (pressées au sens de compression) ; les mots-pivots un procédé qui consiste à composer tout un texte avec un mot ou un syntagme répété ; la Poetry Body Music (Poésie Corps Musique) une création utilisant les mots, la voix et les gestes, pensés de façon rythmique ; les équations de pensée une forme utilisant un système de cause à effet, un système de causalité ; les textes de liste des textes constitués de liste ; et les textes pour la performance des textes conçus pour la lecture-performance.
[5] Non paginé.
3 réflexions sur “Contre-mesures [#4]”