Édito poétique. Le 19 août dernier, France Culture diffusait l’émission Le Temps du débat dont le sujet était « La poésie profite-t-elle de l’époque pour se renouveler ? » [1]. À l’issue des quarante minutes que dure l’émission, les auditeurs et auditrices resteront très probablement sur une idée fausse de ce qu’est la poésie actuelle, ayant surtout entendu parler de Baudelaire et de Rimbaud. Ce qui est particulièrement regrettable, car l’espace accordé à la poésie contemporaine, y compris sur une station de radio pourtant consacrée à la culture, est des plus restreint dans le paysage médiatique.
D’autant plus restreint en cette période de rentrée littéraire où domine, seul, le roman. Si la poésie ne peut rivaliser en chiffres de ventes avec ce dernier, il semble plus que jamais nécessaire de rappeler en quoi elle est pourtant essentielle à la littérature : il n’y a pas de littérature possible sans poésie.
Paul Otchakovsky-Laurens n’affirmait-il pas qu’« une maison d’édition sans poésie n’a pas de sens » ? Lui qui disait aussi n’éditer que de la poésie, — déclaration qui pourrait surprendre, sauf à considérer, à la suite d’Hélène Bessette, que « le travail des poètes, c’est frayer la route ». Et l’écrivaine d’ajouter : « Ce sont eux qui […] emploient les premiers moyens, et livrent leur matériau aux romanciers proprement dit, qui n’ont qu’à les employer et à les adapter. » [2]
Dès lors, rentrée littéraire ou non, nous pouvons nous faire les premiers lecteurs et les premières lectrices de celles et ceux dont l’œuvre ouvre des perspectives nouvelles à la littérature d’après : les poétesses et poètes, — de Rim Battal à Perrine Le Querrec, d’Annie Lafleur à Pierre Vinclair, d’Amandine André à Florence Pazzottu, de Lisette Lombé à Marine Riguet, d’Arno Calleja à Natyot, de Pascale Petit à Sandra Moussempès, de Laure Gauthier à Florence Jou, sans oublier l’immense poète Cédric Demangeot, dont la mort prématurée en 2021 laisse une terrible béance dans le champ poétique contemporain —, toutes celles et tous ceux qui écrivent, créent, publient (en librairies ou sur internet), et lisent en public leurs œuvres aujourd’hui.
Les Imposteurs sont et seront toujours attentifs à ces voix nouvelles, parfois tout juste émergentes, de notre extrême présent, — voix singulières auxquelles plusieurs épisodes de nos Contre-mesures sont consacrés. Nous commençons donc une nouvelle série avec quatre poétesses et un poète aux choix esthétiques divergents, mais qui participent toustes au renouveau de l’écriture poétique.

« je parle en forme / de tête je parle en forme de dents » (« Comment n’importe quelle journée fait partie de l’ensemble. Poème en 57 lignes » in Vous êtes de moins en moins réels, page 24)
Laura Vazquez [3], qui a été chanteuse de rue à Séville, en a gardé cette esthétique unique et saisissante de voix de foule, si caractéristique de son écriture que l’on reconnaît entre toutes, notamment dans l’emploi très particulier qu’elle fait du pronom indéfini on (« On se coupe sans le vouloir et derrière la peau / il n’y a pas de vide » p. 52) [4].
Cette anthologie, qui rassemble des textes publiés entre 2014 et 2021, montre toute l’étendue de l’art poétique vazquezien : une écriture où se mêlent formes narratives brèves ou longues et dispositifs textuels, le plus souvent structurés sur une itération unique qui joue comme une ligne de basse continue (— ostinato, par exemple dans le poème « Et / mourir près d’une rivière » pp. 63-113).
Son écriture est également marquée par le recours à une figure de style dont elle est l’inventrice, qui consiste à dupliquer le substantif et son expansion, créant une étrange gémellité : La main de la main (titre de son premier recueil) ou encore « le bruit /du bruit lui-même » (p. 23).
L’esthétique des textes de Laura Vazquez est empreinte d’un chant-parlé qui confère à l’ensemble une dimension psalmodique et hypnotique d’essence quasi chamanique.
« je ne crois pas aux miroirs
coincée dans le miroir comme s’il existait
plusieurs zéros »
(« Comme les miroirs nous surveillent. Poème en 83 lignes », p. 32)

« Plante un baiser sur mes lèvres en larmes,
Comme les bouchers enfoncent,
À côté de l’étiquette prix, une rose vivante
Dans les quartiers de viandes mortes. » (Se coltiner grandir, p. 193)
Révélée lors de la parution de son premier recueil, L’Autre jour, publié en 2020 par les éditions Lurlure, Milène Tournier fait incontestablement partie des voix marquantes du paysage poétique contemporain [5].
La beauté de la langue de Milène Tournier tient en un écrit-parlé, entre vers libres et prose, en constant déséquilibre. La syntaxe, souvent « fautive », fait trébucher la phrase, créant des figures libres saisissantes :
« J’ai regardé doucement
Son soir de mère assise au canapé
Et son chagrin de fille,
D’avoir l’après-midi pour l’éternité
Glissé sous terre son père. » (p. 207)
L’écrivaine, très prolifique, privilégie la forme narrative où elle excelle à isoler les détails en apparence les plus insignifiants de la vie quotidienne. L’accident de langue crée ainsi des contre-figures rhétoriques qui s’écartent non seulement de l’usage ordinaire de la langue mais aussi d’un usage que d’aucuns qualifieraient de « littéraire » :
« J’étais ouïe nue, dans le noir près de l’eau, j’ai posé ma main sur mon ventre, il n’y a pas d’enfant dedans, que des façons d’organes […]. » (p. 183)
« Bien sûr, les nostalgies se mélangent,
Chaque lumière, même d’hiver, endossant
Les profonds juillets aussi de quand tu n’existais pas. » (p. 135)
Élevé au rang de dispositif textuel dans Je t’aime comme (Lurlure, 2021), nous retrouvons ici le système comparatif foisonnant, propre à l’autrice, qui fait partie intégrante de son processus créatif.
« Un souvenir d’enfance
À l’âge adulte.
Comme avoir
Le mur d’en face
Dedans les yeux » (p. 23)
Chacune de ses trouvailles est un véritable miracle de déséquilibre et de désordre, sans pour autant créer un état de tension dans l’écriture (ce qui serait plutôt le cas chez Dominique Quélen notamment), mais plutôt une réconciliation.
« Je lui ai parlé de la neige et la caissière
En pointant avec son doigt en haut a dit :
‘’Il a la rage.’’
Et c’était beau que la neige
Puisse rejoindre son impensable rime,
Neige et rage. » (p. 200)
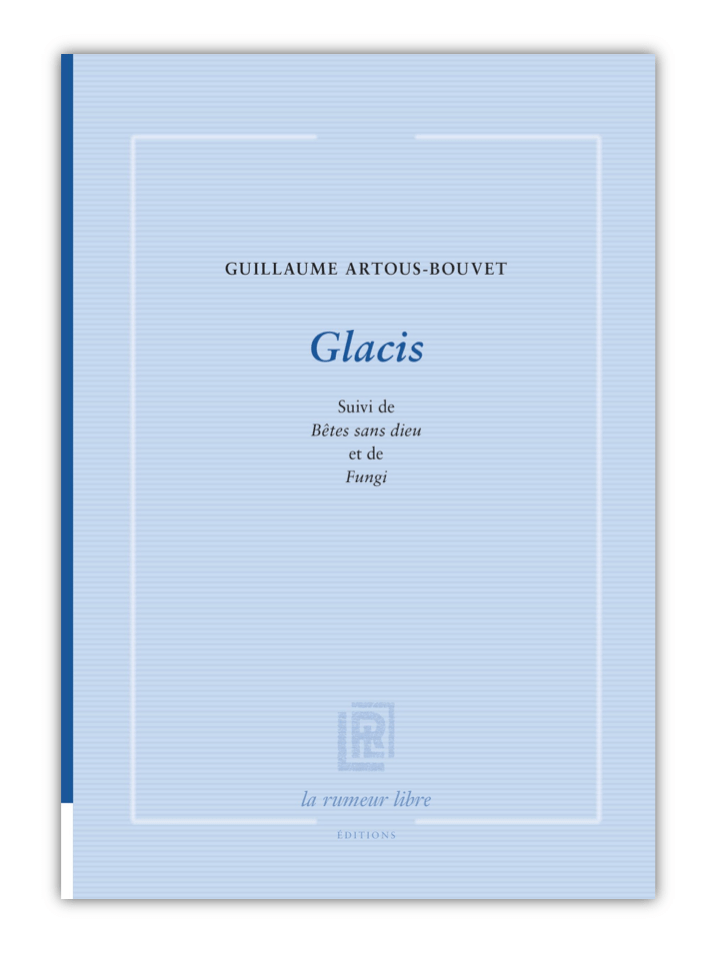
« Cela, qu’inimagine : vague quelle de terre, au recueil (soie s’annèle sous mûre, rombrant). Hors demeure, ecclésial : où se cerne mourir. Hors encore exhaustion de la pierre qui poivre. Hors garance de neige ponctuée. Si saillissent fenêtres, à troncs purs : où tout voir (la laine d’infini, littérale : quelque écume incessée, sous enchant : et la pierre d’un ciel). » (Glacis, p. 45)
Guillaume Artous-Bouvet poursuit, livre après livre, l’une des œuvres les plus singulières de notre littérature [6]. Ici, ni dispositif ni performance. Seul compte le travail de la langue dans la langue. Une langue morte qui aurait été immergée dans un bain de jouvence pour revenir à la vie, sans être un ancien français artificiellement ressuscité, mais une langue qui, depuis cet ancêtre lointain, serait totalement réinventée par le poète. Une langue qui donnerait représentation de sa propre énonciation, théâtre d’elle-même, et lieu de son propre drame.
« Hôte nuit monétise, au pli presque. Âtre, tissu de bleu, fasse chambre. Draps quels, qui ferment mols, dans un art : bleu de foudre, fibré. L’œil se chaîne, à clarté (rare rose descend, de lumière). Bleute voire que soie (même bleu), fasse ciel : un blanc s’étoile nu, qui s’effondre. La laine, sous le pas, s’enfonçant (ou d’herbage usiné) : dans le bleu. » (ibid. p. 10)
Langue inventée, disais-je, telle celle des alchimistes, cryptée pour ne pas être comprise des profanes. Le secret étant l’une des principales clés de lecture de l’œuvre de Guillaume Artous-Bouvet, ainsi que ce dernier le révèle lui-même dans l’avant-propos de son très beau Tantris (Tituli, 2021) : de livre en livre, sa langue ne cesse de s’intensifier de son impossibilité à signifier.
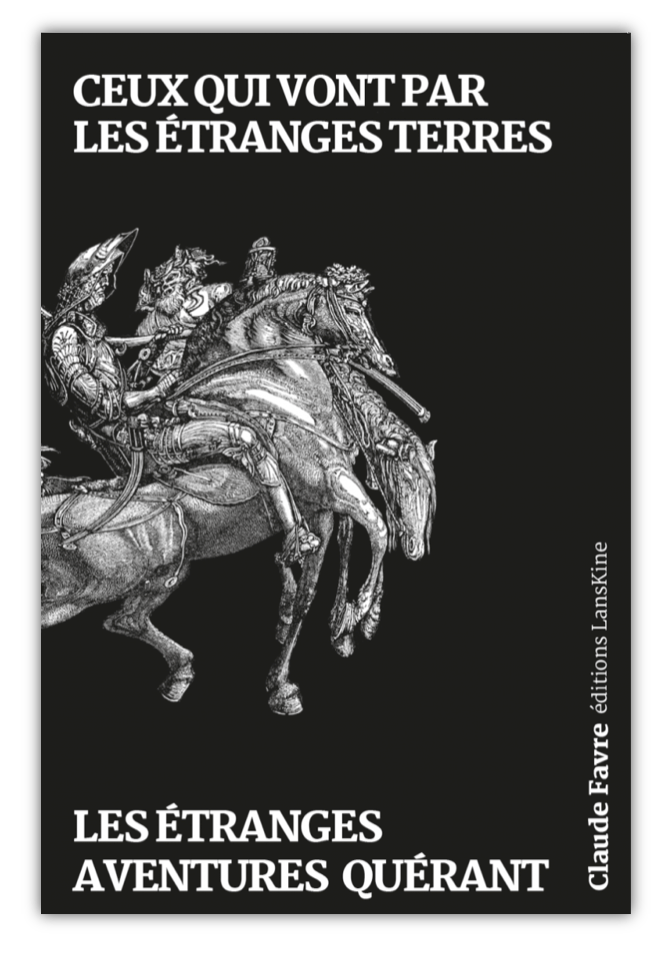
« Te souviens-tu combien les mots ont le sommeil léger. D’alertes. Fond dictionnaires, plus que des mots oubliés, résines, flèches, boomerangs. Qui distance mettent entre les choses. Ou chantés dans des wagons de rouille, derrière des dunes sifflés, fond gorge sèche. De quelle guerre survivant, l’espoir en fugue, réfugiés, mots expulsés, déserteurs, à l’abandon. Quand les bateaux quittent vraiment les quais. Digues, rires mêmes, le ciel parfois a gueule d’ange. De quelle guerre, n’imagine. » (Ceux qui vont par les étranges terres les étranges aventures quérant, p. 33)
Après les deux remarquables Crever les toits, etc. (Les Presses du réel, coll. Al Dante, 2018) et Sur l’échelle danser (Série discrète, 2021), la poétesse Claude Favre fait paraître chez LansKine un nouveau livre où l’écriture fait entendre la part inouïe du langage : les souffles et les silences. Au pluriel. On sait que la croyance selon laquelle les Inuits auraient des dizaines de mots différents pour désigner la neige et la glace est infondée ; cependant l’idée mériterait d’être transposée ici tant les mots souffle et silence semblent pauvres pour retranscrire toute la richesse de cette vie silencieuse qui circule dans le texte entre les phrases de la poétesse.
« Et puis, insistant le gosse laveur de pare-brise, agile, déjà loin, qui imagine.
Imagine, pour les fous les échappées de mots ça, à creuse langue déhanche, coupe. Des mots dans l’arrière-crâne tapant, d’alertes bourbier tapant.
Le monstre plein d’espérance.
Les silences forcés.
Les papillons. » (p. 66)
Ces souffles, ces silences, ne sont pas seulement représentés par les grands espaces laissés blancs sur les pages. C’est un chant silencieux auquel la poétesse répond : « Et la langue des autres, en grande silence. / Qu’est-ce qu’on fait du silence. » (p. 12) écrit-elle, modifiant le genre du mot silence et ne terminant pas la phrase de tournure interrogative par un point d’interrogation pour mieux faire dissoner le poème.
« Les mots qui tentent le silence, les convoquer, qui ne peuvent se taire, raclent sous la langue, trouent tête et ventre, torturent, déchirent, exhibent les souvenirs, leurs diffractions. Et couinent, couinent. Et d’un seul mot, un sale petit mot arrêté contre les dents, qui fait ravage des autres, boucherie. Léger parfois, perdre. » (p. 12)
Rien de fabriqué dans ce livre. Une émotion brute. Viscérale. L’écriture ne prend pas la place de. Elle est un répons inversé : ici c’est la soliste qui répond au chœur silencieux. Chaque phrase (dés-)articulée est la mastication d’une parole tue. D’où ces syntagmes épars, ces phrases interrompues, échouées.
« Dire les mots, imagine dire les mots de ceux qui s’arrachent, des marécages, la force des forces, n’attaquent, des espoirs, ne font mal aux autres mais s’arrachent, des mélancolies. Se récitent des poèmes, font les collines rouges et dansent, dansent sur la longue route, dansent, à vif dansent. Imagine. » (p. 45)

« sache-le ma mise à l’eau n’a rien de périlleux premier réflexe sucer mes doigts toiser les teintes de blond à venir je sais le vent et les courants mes muscles souples les créatures je sais mes traits ma clairvoyance mes poumons de deux étages vivre sous l’eau veut dire amour passer la tête excuse le corps les bras tendus de lents mouvements propulsent ma forme je deviens phoque baleine large pièce d’eau fraîche » (MONUMENTS, non paginé)
MONUMENTS est une immersion dans l’intimité d’un couple d’artistes, la poétesse Vanessa Bell [7] et son compagnon Kéven Tremblay qui signe les photographies argentiques de l’ouvrage. Elle et lui racontent, depuis la pointe Est de la Nouvelle-Écosse jusqu’à Terre-Neuve, le traversier, les nuits passées sur le sol, les désirs qui voyagent, entre territoires réels et occupation rêvée.
Vanessa Bell, Kéven Tremblay et le designer Maxime Rheault, à qui l’on doit le canevas noir et blanc qui évoque les Colonnes de Buren, ont créé un véritable livre-objet poétique. Non pas au sens où ce livre d’artiste serait un « beau livre », — il l’est, certes, et sera mis en avant par les libraires comme tel —, mais dans le sens où cette œuvre (et je parle ici non seulement de l’ensemble textes-photos mais aussi du livre lui-même en tant qu’objet désirable que l’on peut toucher) interroge la matière même de ce que peut être un livre aujourd’hui.

La dimension botanique, bien que présente dans l’ouvrage, est rarement évoquée par les critiques [8]. Et pourtant, la place de la flore dans le livre rattache assez intimement l’objet produit à sa propre origine végétale. Car MONUMENTS confirme que la poétique de Vanessa Bell est un art primitif, une poétique des origines du geste créatif, toujours profondément ancré dans les corps.

« je te saisis ma bouche d’accueil contre tes gloires c’est une prière je te veux beau d’avenir j’évoque frontières et effritements la terre ferme d’où nous venons tu te refuses les mains défaites tu dis abris et les brindilles versent leur sang expéditifs nous nous soulevons s’il nous faut retourner retournons à la mer »
Ce livre de l’ensauvagement du désir à l’état presque brut, livre des origines du geste d’écrire, est profondément incarné. L’écriture, empreinte d’une intense sensualité, montre que le mouvement d’écrire vient du corps, le désir s’incarnant ici dans les paysages figés dans les photographies et les souvenirs, tels des monuments, en une dramaturgie joyeusement douloureuse des territoires fantasmés.
« Lorsqu’on écrit, confiait l’écrivain Jens Christian Grøndahl dans un entretien, l’impermanence perd un instant son pouvoir impitoyable. […] J’ai toujours pensé que l’écriture était liée à la perte. Écrire, c’est s’efforcer de vivre avec elle. […] Le danois est un idiome ambigu, avec des ombres. C’est la langue des paysages aux couleurs pâles, des espaces incertains entre la terre et l’eau. » [9]
En notant cet extrait de l’entretien de l’auteur de Bruits du cœur, je ne pensais évidemment pas à ce moment-là que, quelques années après, je rapprocherais ces propos de l’œuvre d’une jeune poétesse québécoise. Et pourtant, s’il est bien une poétesse qui, aujourd’hui, écrit dans « la langue des paysages aux couleurs pâles, des espaces incertains entre la terre et l’eau », c’est assurément Vanessa Bell.
Laura Vazquez, Vous êtes de moins en moins réels. Anthologie 2014-2021, collection Poésie, Points, mars 2022
Milène Tournier, Se coltiner grandir, Lurlure, septembre 2022
Guillaume Artous-Bouvet, Glacis suivi de Bêtes sans dieu et de Fungi, La rumeur libre éditions, novembre 2021
Claude Favre, Ceux qui vont par les étranges terres les étranges aventures quérant, LansKine, juin 2022
Vanessa Bell, avec des photographies de Kéven Tremblay, MONUMENTS, dir. artistique Maxime Rheault, éditions du Noroît, août 2022
[2] Citation tirée d’un volume d’essais et d’entretiens d’Hélène Bessette en préparation aux éditions Attila.
[3] À lire dans Les Imposteurs, notre critique de La Semaine perpétuelle : https://bit.ly/3DiC1Gx
[4] Parmi les nombreuses occurrences, les lecteurices pourront se reporter notamment aux pages 117, 217, 223, 255, 265, 294, 295, 296.
[5] À lire dans Les Imposteurs, notre grand entretien avec l’autrice : https://bit.ly/3eC8HR3
[6] À lire dans Les Imposteurs, notre critique de Prose Lancelot : https://bit.ly/3ByYPk7
[7] À lire dans Les Imposteurs, notre grand entretien avec la poétesse : https://bit.ly/3eLV4Pj ; et notre critique de De rivières : https://bit.ly/3S2rGTm
[8] C’est la poétesse Noémie Pomerleau-Cloutier qui a été associée au projet comme consultante en botanique. À lire dans Les Imposteurs, notre grand entretien avec Noémie Pomerleau-Cloutier : https://bit.ly/3S6c9lv
[9] Supplément Livres du journal Le Monde, 23 mars 2018.
Une réflexion sur “Contre-mesures [#3]”