- Commentaire
- Reblog
-
Souscrire
Abonné
Vous disposez déjà dʼun compte WordPress ? Connectez-vous maintenant.
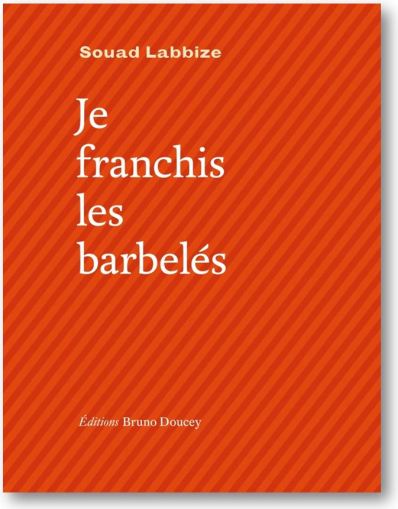 Écrivaine, poétesse et traductrice, Souad Labbize a vécu à Alger, Tunis, puis en Allemagne avant de s’établir à Toulouse. Elle est autrice d’un roman, J’aurais voulu être un escargot (Les Lisières, réédition 2019), de recueils de poèmes tels qu’Une échelle de poche pour atteindre le ciel (Al Manar, 2017) et Brouillons amoureux (Les Lisières, 2017, édition bilingue français-arabe), et d’un récit sur le viol, Enjamber la flaque où se reflète l’enfer (éditions iXe, 2019, édition bilingue français-arabe).
Écrivaine, poétesse et traductrice, Souad Labbize a vécu à Alger, Tunis, puis en Allemagne avant de s’établir à Toulouse. Elle est autrice d’un roman, J’aurais voulu être un escargot (Les Lisières, réédition 2019), de recueils de poèmes tels qu’Une échelle de poche pour atteindre le ciel (Al Manar, 2017) et Brouillons amoureux (Les Lisières, 2017, édition bilingue français-arabe), et d’un récit sur le viol, Enjamber la flaque où se reflète l’enfer (éditions iXe, 2019, édition bilingue français-arabe).