
Poétesse et professeure de théorie littéraire à l’université de Rio de Janeiro, Patrícia Lavelle réside actuellement en France dans le cadre d’une année sabbatique destinée à l’écriture de l’essai Poétique translangue, soutenu par le CNL. En poésie, elle est l’autrice de Bye bye Babel, paru dans la collection Al Dante aux Presses du réel, et de Sombras Longas/Ombres longues, publié au Brésil par Relicário edições. Quelques extraits de ce deuxième livre peuvent être lus en français dans la revue Journal et dans l’anthologie de poésie brésilienne contemporaine publiée chez Al Dante aux Presses du réel en 2022. Cet entretien porte surtout sur Bye bye Babel et interroge son rapport à la traduction et au geste translangue. Cette pratique de l’écriture poétique est chez l’autrice l’occasion d’une réflexion plus large sur le déplacement langagier opéré dans un processus d’écriture impliquant le multilinguisme.
Rodolphe Perez : Dans ton recueil Bye bye Babel, publié aux Presses du réel, tu proposes la « réécriture en français d’un ouvrage d’abord écrit en brésilien », autrement dit ta langue natale. Pourquoi as-tu voulu réécrire tes propres textes en français ?
Patrícia Lavelle : J’ai écrit la première version de Bye bye Babel dans un double désir de retour à ma langue maternelle et à mon pays d’origine après quinze ans d’immigration en France, où j’ai soutenu ma thèse de doctorat en philosophie en 2006. Ce travail universitaire est devenu un livre, Religion et histoire : sur le concept d’expérience chez Walter Benjamin (Cerf, « Passages », 2008), puis j’ai fait des articles, dirigé des collectifs. Bref, j’ai passé plus de dix ans à écrire exclusivement en français, qui est une langue apprise à l’âge adulte… Ce n’est pas quelque chose que j’ai spécialement recherché, c’est arrivé ainsi, sans que je sache nommer cette pratique d’écriture que maintenant j’appelle « translangue ». Je n’écrivais alors que de la prose théorique, mais la création poétique est en lien étroit avec cette expérience de l’altérité langagière, de l’éloignement par rapport à ma langue maternelle, la seule que j’ai parlée dans mon enfance.
Le premier cycle du long processus d’écriture de Bye bye Babel a accompagné ma réinstallation à Rio en 2014. Le manuscrit était pratiquement prêt en 2016, année où il a obtenu un prix brésilien destiné à des ouvrages inédits, avant de paraître en 2018 avec quelques ajouts. Mais ce retour d’immigration a été parsemé de nouveaux départs et interrompu par des longs séjours à Paris, où j’ai notamment vécu pendant les années pandémiques de 2020 et 2021, enseignant toujours au Brésil, en mode « distanciel ». Cette situation créait une nouvelle forme de déplacement langagier, activant constamment les deux langues. C’est peut-être pour cette raison que, malgré la publication, la ruine de la tour est redevenue une construction inachevée…
J’avais déjà un nouveau projet d’écriture poétique sur le chantier, mais n’arrivais pas encore à prendre congé de Babel. Cette thématique m’incitait toujours à écrire, et une nouvelle édition brésilienne a vu le jour en 2022, avec plusieurs nouveaux poèmes. Même après cette réédition augmentée, j’ai encore écrit d’autres textes, dans les deux langues, et parfois seulement en français. C’étaient des traductions sans original, écrites directement dans cette autre langue que j’ai commencé à apprendre à vingt ans et n’ai adoptée que plus tardivement encore. Cette hantise, je n’ai pu la conjurer qu’avec l’auto-traduction (ou la réécriture) de l’ensemble du livre en français et sa publication en 2023.
Congédier Babel signifie aussi en prendre doublement congé : deux villes, deux langues – et ainsi dire adieu à toute illusion de monolinguisme. C’est dans ce geste que j’ai retrouvé non seulement la conception thématique de ce premier livre, mais l’élan pour la création poétique en général.
RP : Quelle temporalité sépare ces deux variations du poème et comment a-t-elle influencé la construction du poème en français ?
PL : Le processus de composition de ce livre a été très long. Je dirais qu’il y a eu deux cycles. Le premier, qui s’étend de 2013 à 2017, correspond à l’usage presque exclusif du brésilien, ma langue maternelle devenue un peu étrangère, dans laquelle je voulais récupérer une aisance d’écriture. Même si « Dialogue » était déjà un poème double, écrit en même temps dans les deux langues, et si quelques textes incluent des mots en français ou font référence aux rythmes caractéristiques de la langue française (« Traduzida », « Língua materna », entre autres).
Le deuxième cycle d’écriture correspond à la période de la pandémie, que j’ai passée en France, et inclut des poèmes écrits directement en français. Il a abouti d’abord à la deuxième édition brésilienne du livre, qui rassemble de nouveaux textes. L’auto-traduction de l’ensemble est venue très naturellement dans ce deuxième moment, et c’était un soulagement. J’ai eu besoin de réécrire ce livre en français pour l’achever et me libérer de sa thématique, avant de pouvoir m’engager dans le projet d’Ombres longues, mon deuxième volume de poésie, qui interroge la voix à travers l’image, le reflet. Ce deuxième projet a également deux versions, la brésilienne est déjà publiée depuis l’année dernière et la française reste encore inédite.
Je pense que certains poèmes, « Écho au sonnet », par exemple, ne sont complets que dans leur forme double. Ce texte, en particulier, s’accomplit avec les effets de miroitements, les « échos » produits par la traduction isomorphe, c’est-à-dire faite dans la tradition de la transcréation poétique prônée par Haroldo de Campos, et développée par d’autres poètes-traducteurs brésiliens contemporains, parmi lesquels Paulo Henriques Britto.
Dans ces traductions isomorphes, j’ai cherché à garder le rapport forme-contenu du poème, en produisant parfois de petites variations sur le plan strictement sémantique. Mais d’autres textes ont été vraiment transformés au terme d’un travail de réécriture qui conduit plutôt à une autre version qu’à la transcréation. J’ai parfois transformé des vers libres en prose poétique – dans « Calypso » par exemple – ou modifié significativement le poème et sur le plan sémantique et sur celui de la forme. C’est le cas de « Un rêve », où la version française dévoile une homophonie significative qui n’apparaissait pas dans le texte brésilien.
Parmi les textes écrits en français, « Dans ta langue à toi (variations) » a aussi une version hybride, avec des variations dans les deux langues, incluse seulement dans la deuxième édition brésilienne. Et pour l’édition française, j’ai voulu traduire en brésilien « Manque la suprême ». Ce poème renvoie au titre de la dernière série du livre, « Traduire d’aucun original », qui rassemble les textes écrits en français que je n’ai pas voulu retraduire. Ils sont en quelques sorte déjà des traductions, mais des traductions d’une langue qui manque, ou plutôt d’un manque de langue.
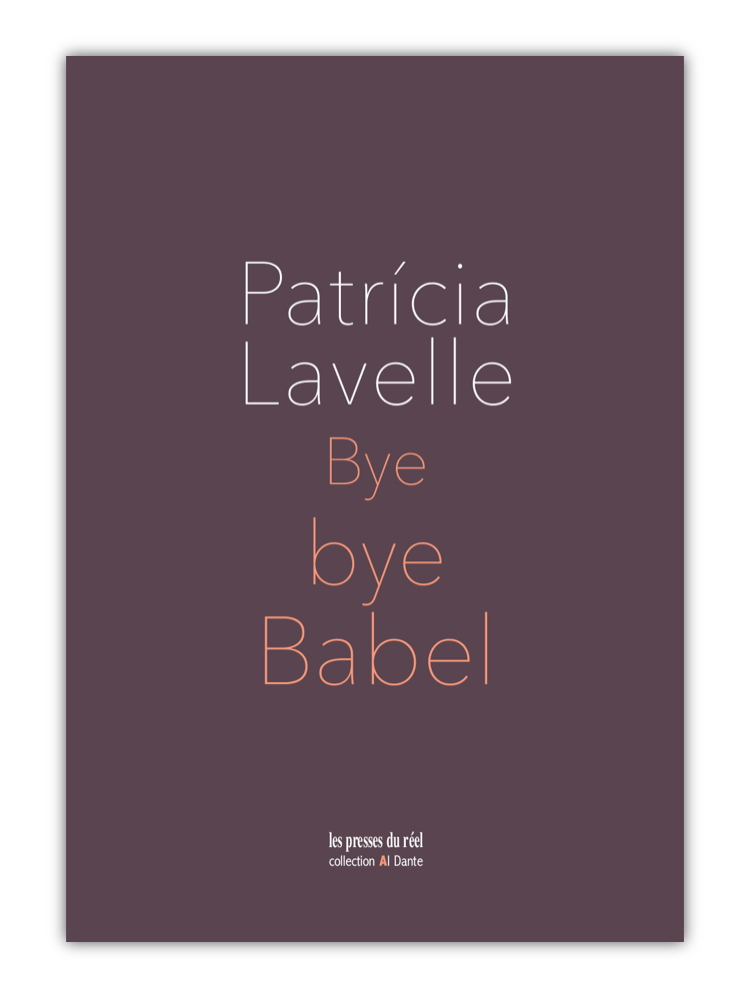
RP : Ce retour à la langue natale est un passage à la poésie. Est-ce que l’usage des langues persiste, dans ta pratique, entre une langue qui serait celle du travail universitaire et savant, et une langue qui serait exclusivement dévolue à la création poétique et à l’œuvre littéraire ?
PL : Non, je ne fais pas cette distinction. Quand je me suis rendu compte que je n’avais pas écrit en brésilien pendant une longue période, je me suis mise à produire des essais dans les deux langues. J’ai pris l’habitude de traduire mes articles dans les deux sens, car il arrive bien souvent que le premier texte soit en français. Mais je réécris beaucoup entre les deux versions, ce qui me permet d’avancer dans une réflexion. Par ailleurs, la séparation entre le travail théorique et la création littéraire ne me semble pas si tranchée. Entre poésie et théorie, il y a aussi des contaminations. Je me suis souvent intéressée à ces passages dans l’étude des œuvres de Walter Benjamin ou de Hans Blumenberg, et maintenant aussi dans celle d’Anne Carson.
Très récemment, un collègue m’a invité à écrire un article pour un dossier académique sur « philosophie et littérature ». C’était pour une revue brésilienne de philosophie qui s’appelle Aufklärung. Le titre allemand en dit long sur le caractère très spécialisé et universitaire de la chose… Comme provocation, j’ai proposé un essai en vers et en prose, où l’argumentation théorique dialogue avec des poèmes. À mon grand étonnement, cela a été accepté !
Les images et des éléments narratifs trouvés dans les textes philosophiques – et même dans les plus techniques –, constituent des matériaux privilégiés pour mon écriture poétique. Ce n’est pas pour rien que l’épigraphe de Bye bye Babel est un passage de la Critique de la raison pure. Kant y évoque le récit de Babel pour pointer les limites des constructions conceptuelles systématiques, c’est-à-dire leur manque de matériaux, et la confusion qui en découle et frappe les rationalistes dogmatiques, et les métaphysiciens en général – ceux qui veulent déterminer la réalité des idées et croient pouvoir connaître ce qui ne peut qu’être pensé. À mon avis, la poésie permet de se détourner de ces métaphysiques de l’objectivation abusive pour continuer à penser encore, et au-delà de la détermination argumentative d’un sens univoque…
RP : Depuis ta position géographique française, empreinte quotidiennement d’un usage professionnel du brésilien, pour la période 20-21, tu évoques une sorte de cohabitation des langues, un peu forcée. Est-ce qu’à ce moment précis il existait un impact sur les domaines artistiques de l’usage des langues ? Ces textes traduits depuis aucun original sont très intéressants dans le rapport à la traduction. Que viennent-ils traduire concrètement ? Est-ce qu’ils reposent sur une construction mentale dans une langue et une transposition écrite dans l’autre ?
PL : Ces textes de Bye bye Babel, que tu évoques, sont parmi mes premiers poèmes écrits directement en français. Au départ, je n’imaginais pas qu’ils pourraient avoir une quelconque réception… Cela m’exaspérait et m’angoissait d’écrire encore des textes poétiques en français, au lieu de continuer le travail que j’avais commencé en brésilien dans mon processus de « retour ». Ces poèmes francophones impliquent beaucoup ma position d’élocution déplacée par rapport à cette langue-là. Et maintenant je crois les avoir écrits justement pour pouvoir mettre en scène cette position d’élocution déplacée, pour pouvoir la penser, la traduire… Ils ne traduisent pas des textes pensés dans « ma » langue, mais plutôt le déplacement langagier lui-même – ce saut périlleux qui est aussi au cœur du travail du traducteur. La notion de « translangue », thématisée dans l’essai de poétique que je prépare actuellement, me permet de nommer ce que j’avais commencé à creuser dans ces poèmes.
Peut-être qu’écrire des poèmes dans « ma » langue était déjà une manière de traduire sans original, c’était déjà écrire avec une oreille étrangère… Pour moi, chaque poème résulte d’une recherche difficile, parfois obsessionnelle. Ils traduisent un manque de langue ou une langue qui manque – une insuffisance productive dans le rapport au langage.
RP : Quelle distinction ferais-tu, depuis ton travail mais aussi plus généralement, entre la traduction et la réécriture ? Car à te lire, à lire ton recueil, on pourrait se demander si chaque traduction n’est pas une nouvelle œuvre et une réécriture.
PL : J’appelle traduction de poésie ce que le poète-traducteur brésilien Haroldo de Campos nommait « transcréation », c’est-à-dire un travail effectivement créatif de transposition du réseau de rapports internes au poème dans un autre poème. Il employait l’adjectif « isomorphe » pour qualifier le texte ainsi produit dans l’autre langue. Une simple traduction littérale du contenu sémantique d’un poème ne serait pas considérée comme une « transcréation ». Je ne pratique pas ce type de littéralisme sémantique. Mais, dans le processus d’auto-traduction, je transgresse parfois les limites de la transcréation introduisant des variations sémantiques et formelles importantes, qui cassent l’isomorphie. Ainsi, le passage au français m’amène à abandonner le réseau de rapports internes au premier poème, et à faire un autre texte. C’est ce que j’appellerais la réécriture « translangue ».
RP : L’hybridation des pratiques d’écriture (poésie, prose, pensée scientifique…) se nourrit d’une navigation permanente entre les deux langues, alors même que tu travailles des auteurs et des autrices d’une troisième langue. Tu es en permanence travaillée par un tiers-lieu syntaxique, par d’autres structures. L’écriture, sous toutes ses formes, est donc d’une certaine manière une permanente exploration babélique – et empirique – des langues.
PL : En effet, merci pour ce commentaire. Tu m’as comprise mieux que je ne me comprends moi-même…
RP : En réalité, tu retournes le déplacement géographique en déplacement intellectuel, tu te sers d’une théâtralisation de la traduction pour ne jamais donner la primauté à une seule langue et tes textes, même lorsqu’ils se font face dans un recueil, se nourrissent l’un l’autre et élargissent le sens possible.
PL : Certes, merci encore pour ce commentaire. J’ajouterais seulement que ce déplacement n’est pas que géographique ou intellectuel, il est aussi affectif. L’ouverture, le refus d’un enfermement monolingue, s’inscrit aussi dans le vécu, dans le corps, dans les relations interpersonnelles – l’écriture poétique est une traduction de l’expérience dans toutes ses dimensions. Et je tiens à ce mot d’expérience contre celui d’expérimentation, qui vient du vocabulaire de la science des temps modernes.
RP : Penses-tu toujours les poèmes avec la langue dans laquelle tu les écris ? Dans quelle langue est « l’oreille étrangère » qui construit la parole avant de la mettre à l’écriture ?
PL : Je ne sais pas toujours dans quelle langue je pense… La pensée traverse vite d’une rive à l’autre, apportant toujours des mots, des rythmes. Pour te répondre précisément : oui, cela m’arrive de concevoir en français un texte que je dois écrire en portugais, et vice versa. Mais à vrai dire, je pense dans ce français d’étrangère que je parle. Ma voix a toujours un accent, parfois il est presque imperceptible, parfois il est très fort… Je crois que l’écriture traduit cette voix-là, marquée d’un écho, d’un air d’ailleurs.
RP : L’écriture « translangue » consisterait donc, dans ce déplacement qui est une transition, à habiter une autre langue pour donner au poème un sens original et différant (au sens de la différance chez Derrida) ? Ou disons que quand tu traduis, tu n’écris plus le poème depuis la langue d’origine mais depuis la langue d’arrivée elle-même.
PL : Pour traduire, on fait un saut. Il y a toujours un moment « entre » les deux langues. Dans l’auto-traduction poétique que j’ai pratiquée ce n’est pas différent. Il y a quelque chose qui s’opère dans le passage de la langue d’origine à la langue d’arrivée, quelque chose qui permet aussi ce passage avec ses pertes et ses gains. J’appelle cela tout simplement « langage », bien que le sens profond de ce mot soit très mystérieux. La différence de ma pratique poétique de l’auto-traduction, par rapport à la traduction de poésie en général, est de pouvoir introduire des variations, créer des écarts très importants. La variation s’écrit déjà dans la langue dite d’arrivée, avec les matériaux nouveaux qu’elle me fournit.
Entretien réalisé par courriel en septembre 2024. Propos recueillis par Rodolphe Perez. Photographies de l’autrice © Ozias Filho.