Édito poétique. À l’issue d’une rencontre en librairie, Perrine Le Querrec me disait qu’elle ne ponctuait plus ses textes de la même manière depuis qu’elle vivait à la campagne. Sa respiration avait changé. La respiration de ses textes avait changé.
Cette réflexion chemine et plus tard je pense à Apollinaire qui supprime la ponctuation de ses poèmes. Son livre Alcools paraît en 1913. Sidération de penser à cette œuvre déponctuée, publiée avant la Première Guerre mondiale, conflit pour lequel le poète a combattu sur le front de Champagne et durant lequel sont utilisés pour la première fois des gaz dits « de combat » (dichlore, phosgène allié au chlore, et gaz moutarde) [1].
Imaginer à rebours cette possible asphyxie du texte et celle des lecteur·ices qui doivent en trouver le rythme respiratoire. Lire et écrire avec son corps.
Débarrassée de ces encombrants prétextes que sont la fiction et la narration, l’écriture ne peut venir que du corps, que ce dernier soit habitable ou inhabitable, malade et vieillissant.
Lire écrire. Lirécrire. Respirer le texte. Respirer le silence.
« Il n’y a pas d’avoir, que de l’être qui réclame le dernier souffle, l’étouffement » écrit Kafka dans Aphorismes de Zürau [2].

Sur la couverture apparaît le titre démembré, mot par mot, en police Combat (une typographie créée par Martin Desinde en 2015), et, plus bas, le nom de l’autrice en Baskervvol. La police Combat a ceci de particulier que les empattements très marqués rappellent la forme du sabot des ongulés. Le papier de couverture, que j’imagine recyclé, est bicolore, gris et vert.
Avant même d’ouvrir ce livre paru aux éditions du Commun, tout ceci nous fait signe : animal, cycle, fabrication, dualité. Ce qui a servi à la confection de l’objet a déjà un passé, une histoire. Ce livre est un livre du milieu, avec un avant et un après, un intérieur et un extérieur. Une dualité que la poétesse énonce ainsi : « J’ai vécu 18 ans à l’intérieur d’une ferme / j’ai vécu 18 ans à l’extérieur d’une ferme » (p. 16).
Mon corps de ferme s’ouvre sur un texte qui évoque la tue-cochon et les femmes « dans le hangar devenu boucherie » qui « rendent le cri du sacrifice comestible » (p. 7). Dans le texte suivant, Aurélie Olivier parle du mouvement Jeunesse Agricole Catholique. La succession des deux textes crée, par la dynamique de lecture, un tiers sens (ici une parodie d’eucharistie). L’autrice va procéder de même par la suite. Mon corps de ferme n’est pas un recueil de poèmes mais un livre de poésie, l’ordre dans lequel nous lisons les textes faisant sens.
« Le conditionnement est plus ou mois
tendre à la première bouchée
mais quelques voyages plus tard
je sais qu’il n’y a pas de société séparée
de la manière dont elle se lèche les babines
de la manière dont, sans fin, elle affame » (p. 16)
Le procédé de composition du livre rappelle celui du montage parallèle qui associe deux plans sans simultanéité temporelle. Nous pensons notamment à la séquence finale très commentée du film de propagande d’Eisenstein, La Grève (1925), dans laquelle le cinéaste juxtapose le massacre des ouvriers par l’armée tsariste et une scène d’égorgement d’un bœuf dans un abattoir. C’est ce procédé qui confère à Mon corps de ferme sa polysémie et sa force.
Le parallèle entre celles et ceux qui vivent à la ferme et les animaux qui y sont élevés est mis en évidence dès le premier poème (« je t’engraisse, tu m’engraisses » p. 7.), jusqu’au dernier (« se rêver génisse » p. 55). Abordant la question du congé maternité, l’autrice écrit : « A minima, l’élevage sera intensif » (p. 13).
« Les enfances encore en pyjama
les techniciens sont accueillis au café
lait, Chocapic, produits phytosanitaires
Tout est mélangé
0
Mon corps, de plus en plus, se renferme » (p. 34)
Mon corps de ferme est une œuvre poétique autant que politique brillante et forte, qui pose, dans sa structure même, sans la formuler, la question de ce qui nous détermine selon le milieu où nous avons été élevé·e·s, du conditionnement et de ce que ce milieu fait aux corps, au corps de ferme, au corps de femme (« Il paraît que ce qui n’est pas articulé parle / depuis le corps » p. 44).
« Je retrouve mes débuts
je retrouve mes débuts de phrases
ils se lient les uns aux autres
jusqu’à détacher des phrases entières
qui ne font plus sans blanc
0
Le ferme me lâche
je sors de taire » (p. 53)

Avec son animal errant, retour d’abattoir :::, Claro réinvente un geste d’écriture proto-scriptural, d’avant l’écriture, avec ce quelque chose qui prendrait source et forme dans l’art pariétal, sorte de rituel dont les intentions se seraient perdues dans la nuit des temps, laissant seulement les marques transmises ouvertes à toutes les interprétations.
Cette traînée de points, par exemple, n’est pas un signe de ponctuation mais un symbole, un hiéroglyphe. Ce qui importe ce n’est pas le sens possible de ce symbole mais ce qu’il dit de lui-même : je suis le signe qui fait signe, la clarté dans la ténèbre du sens [3].
« (6)
la langue ni outil ni sèche argile
de la chair à mâcher que l’on recrache
honteux au fond d’une bouche infantile
ni une eau qu’à brasser on changerait
en liesse où disperser nos jeunes peurs
nulle main agile et nul regard patient
ne font que la fleur croît au seul contact
de l’idée jaune à notre insu cueillie
la forme laisse un creux où nulle empreinte
n’ose imposer se trace et dans le vide
sans cesse croissant s’étend une tâche
plus vorace qu’un trou par où passe
le corps et avec lui tout ce qui rage » (p. 16)
Ce qui nous saisit immédiatement à la lecture de ce livre c’est l’intensité du geste d’écriture. Le texte est travaillé et porte les marques de ce travail, — et j’emploie ici le mot dans son acception étymologique : c’est un labeur, un labour : le soc qui tranche la terre (« racler un peu de sens / à l’horizon du père » p. 77), un quartier de viande découpé à la feuille par le poète-boucher (« le couteau sur la table indique un point / précis qui déjà rougit sur la nuque » p. 18), un « paysage de muscles d’os de viscères » (p. 99).
Ça coupe, ça casse, ça cisaille. La table de l’écrivain est un billot.
Dans la seconde partie du livre (« ::: retour d’abattoir »), le geste bascule dans un mouvement post-scriptural. Claro y explore un devenir de l’écriture. Par un jeu typographique, le poète vient placer entre les lignes d’une portée invisible, des mots ou des groupes de mots, au-dessus ou en dessous de la ligne principale, en exposant ou en indice. Le poète invente ainsi une échelle de hauteurs, a priori sans rapport avec l’acoustique, créant à l’œil un effet de perspective, qui n’est pas seulement visuel mais vient percuter notre lecture par un phénomène de distorsion du langage.
« faire glisser le ciel l’amener à s’absenter silence qu’il frotte la
terre frotte le sel de la terre frotte la plaie toujours
(r)ouverte s’épanche en orbes souples en nappes ductiles en
un retournement dont nul de sait s’il est gloire ou deuil » (p. 138)
Œuvre d’un poète de science-fiction du langage, animal errant, retour d’abattoir ::: est une machine à explorer la langue et le temps.
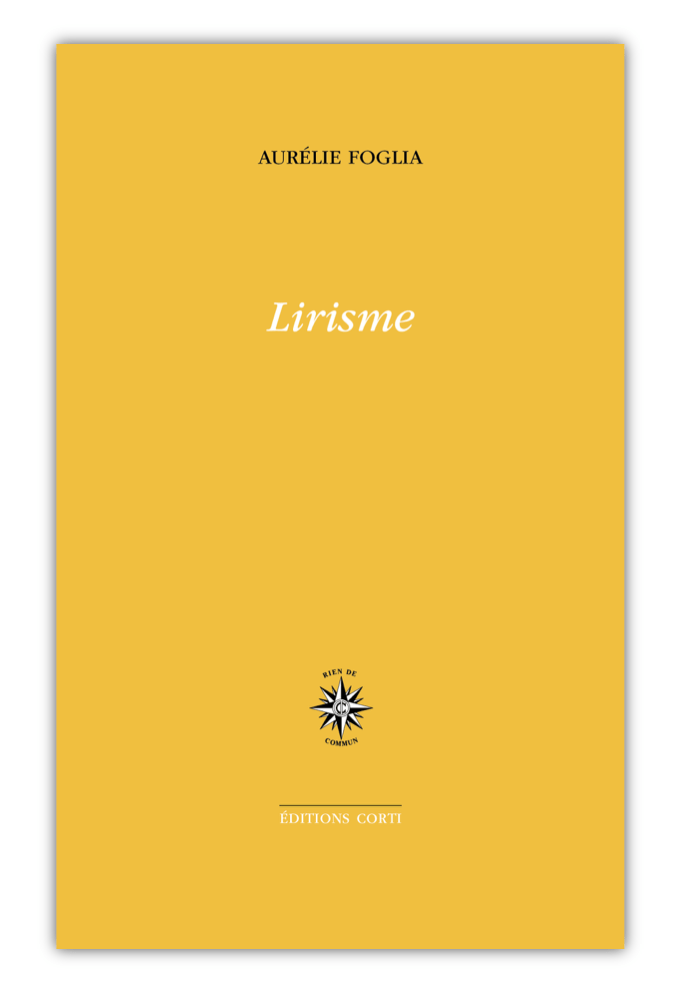
« autre chose qu’une chose / est un livre son animal de / nuit », écrit Aurélie Foglia (p. 243) dans son très beau Lirisme publié chez Corti. Son animal errant ?
Lirisme est un magnifique autoportrait de la poétesse en lectrice. Et puisque le livre est un miroir, c’est autant lui qui s’exprime que l’autrice : « il fait blanc // il fait si blanc ici », dit le livre (p. 221).
Dès lors s’établit une géométrie des regards, une symétrie inversée ou renversante : « tes yeux mangent ma / digestion des yeux // diamétralement opposés » (p. 234). Les yeux cherchent au-delà de l’obstacle du langage, une transparence : « sous les phrases voyantes des choses / sont là mais on ne me voit pas à travers » (p. 96).
Oublions les « phrases voyantes » et « écout[ons] // le silence // rafraîchir / les lignes » (p. 67), la respiration profonde du livre, « visage coupé par le souffle » (p. 69).
La poétesse évoque ainsi le mouvement respiratoire du texte et l’immobilité de la main qui tient le livre :
« l’emploi massif de poumons
personnels possessifs mène à
quoi entre vos mains
0
inexpressives ? » (p. 55)
La lecture nous affecte physiquement, et particulièrement celle de la poésie :
« le compact de la prose ne me fait pas
l’effet physique des vers
0
c’est quelque chose qui fait
quelque chose » (p. 93)
Parmi ses euphorismes, la poétesse confie :
« vivre livre-mort
donne corps prend
corps vous prête
nom vous prend
votre corps vous rend
votre nom » (p. 123)
Lirisme dit le blanc, le vide, le silence du livre-linceul, mais aussi la mémoire et cette « langue [qui] a vieilli avec toi » (p. 163). Car le livre est là « quand la langue de son / absence a tout vidé » (p. 273).

« Tous les verbes de ce livre, chaque nom de ce livre pourraient être remplacés par le mot ‘‘nuit’’ — un cycle de l’effacement » écrit Jean-Philippe Cazier (p. 26) dans son magnifique Page blanche Alger paru chez LansKine, l’un des plus beaux livres publiés cette année. Ce livre du blanc, l’auteur nous dit en faire un livre qui ne peut pas s’écrire, un livre du conditionnel. Celui de la disparition de la mère.
« Le récit serait d’un visage (ce visage), de son ombre et du monde de ce seul visage (paysage), comme un seul désert dans l’univers entier, à peine une seconde dans la vie millénaire de ce monde. Ou la mer, une mer seule dans l’univers entier. Le texte serait les mots de ce visage de sable, son écho sous forme de chant. Ou bien les mots seraient là, sur la plage, pour d’autres mots qui ne diraient rien, parleraient pour davantage de silence, mots d’une voix toujours de l’enfance : voix désertiques, pages blanches — un livre et du sable. » (p. 7)
Page blanche Alger est un livre sur l’écriture d’un livre : « Il s’agit d’une écriture de l’oubli, alphabet sans langue, sans connaissance des mots : écriture sans mots, élaboration de l’oubli. » (p. 16)
Le livre s’écrit dans le geste impossible de s’écrire. Dans sa disparition.
« C’est un verbe, un poème d’une sobriété arithmétique. Ce sont plusieurs phrases, des fragments de phrases, notées sur un carnet. Des personnages y vivent et qui sont des mots. Ce serait comme une rédaction d’enfant, quelques lignes écrites qui ne résolvent rien. Ou une image invisible, secrète, qui n’aurait jamais existé. Le texte s’arrêterait là mais, par-delà la fin du texte, l’absence des mots continuerait. » (p. 50)

Je ne pouvais pas terminer cet épisode de Contre-mesures sans évoquer quélen = enqulé de Dominique Quélen paru chez Louise Bottu. Livre du dérèglement linguistique, quélen = enqulé paraît sans doute un peu à part à la suite des quatre ouvrages que nous venons d’aborder. Et pourtant.
Œuvre dysfonctionnelle, quélen = enqulé est un texte qui vient lui aussi du corps. Les contraintes que l’auteur se donne délimitent une sorte de cadre à une expérience ici poussée à son extrême. Procédant par effet de sur-saturation, Dominique Quélen nous fait entendre le bruit du signe à plein volume, sa matérialité même (« avec énormément de bruit très solide », p. 81), produisant une sensation d’assourdissement et de vertige.
« Chacun est au milieu de tous comme est chaque partie du corps une fois lâché ce qui était tenu qui deux ou trois fois moins loin est visible à l’avant de la chose dite avec un objet qui empêche et produit un son qu’on entend plus tard ou à côté d’un autre on a trop avec l’oreille en général. » (p. 69)
Le texte nous entraîne dans des séries de boucles vertigineuses où le langage se désaxe sans cesse :
« On parle un instant dans un sac on y vit plusieurs jours un produit est répandu qui facilite il se présente à la vue comme une épaisseur nouvelle où étaient depuis longtemps une langue et un petit vocabulaire de plus ou moins un mot très facilement difficile à comprendre. » (pp. 81-82)
Dans la dernière et meilleure partie du livre (« Tu te tais »), les bouches « parlent avec un bruit de choses qui roulent sur elles-mêmes en disparaissant résumées à un seul bruit » (p. 63). Ici, « le son pour vouloir dire te sort de l’angle inférieur des dents » (p. 82). Le langage est alors cette chose pathologique, cette excroissance expulsée d’un corps en proie au bégaiement de la langue.
Aurélie Olivier, Mon corps de ferme, éditions du Commun, janvier 2023
Claro, animal errant, retour d’abattoir :::, collection Poésie/Flammarion, Flammarion, janvier 2023
Aurélie Foglia, Lirisme, Corti, novembre 2022
Jean-Philippe Cazier, Page blanche Alger, LansKine, janvier 2023
Dominique Quélen, quélen = enqulé, Louise Bottu, mai 2022
[1] https://www.museedelagrandeguerre.com/histoire-grande-guerre/gaz-combat/
[2] Cité par Sereine Berlottier dans Avec Kafka, cœur intranquille (Nous, 2023), p. 89. L’extrait cité provient de l’édition de Roberto Calasso, dans la traduction d’Hélène Thiérard (Gallimard, 2010).
[3] Mathieu Bénézet, cité en exergue page 23 : « j’ai quitté le sens quand / j’ai commencé d’écrire ».
Une réflexion sur “Contre-mesures [#6]”