
Née en 1986 à Perpignan, Laura Vazquez est élevée par sa grand-mère illettrée, « sans langue » [1]. Enfant, elle écrit des « prières contre la mort » [1]. Ce mysticisme ne la quittera pas. L’adolescente s’ennuie au collège et au lycée. Il en sera de même à la faculté de Lettres. Elle est cependant bien déterminée à écrire, même si elle écrit alors de « petits livres 80 % mauvais » [2]. Installée à Marseille pour être plus près du Centre international de la poésie de Marseille (Cipm) [3] où elle passe ses journées à lire à la bibliothèque, — « la plus grande bibliothèque de poésie d’Europe » précise-t-elle [1] —, ses premiers textes sont publiés en 2012 dans la revue BoXoN [4] et par Marie-Laure Dagoit aux éditions Derrière la salle de bains [5]. La Main de la main reçoit en 2014 le prix de la Vocation. Ce premier recueil paraît aux éditions Cheyne. La même année, la jeune poétesse crée la revue de poésie Muscle [6] qu’elle co-dirige aujourd’hui avec sa compagne Roxana Hashemi. Mais c’est son premier roman, La Semaine perpétuelle (éditions du sous-sol, 2021 ; rééd. Points, 2022) [7], unanimement salué par la critique, qui la fait connaître d’un plus large public. Alors que son anthologie personnelle, Vous êtes de moins en moins réels [8], publiée chez Points l’année suivante, confirme la singularité de son écriture, le génie à l’état brut de la poétesse se déploie magistralement dans son merveilleux Livre du large et du long, épopée hallucinante et hallucinée qui paraît aux éditions du sous-sol.
Avant d’aborder votre nouveau livre, je voudrais revenir sur Vous êtes de moins en moins réels (Points, 2021), votre anthologie que vous dédiez « à tout le monde ». Cette dédicace, très universaliste, ne surprendra pas celles et ceux qui connaissent déjà votre œuvre. J’écrivais, à propos de cette anthologie, que vous aviez gardé de votre expérience de chanteuse de rue à Séville « cette esthétique unique et saisissante de voix de foule […] notamment dans l’emploi très particulier [que vous faites] du pronom indéfini on » [8]. Antonin Artaud disait qu’il écrivait pour les analphabètes, — étant entendu que pour est ici employé au sens de « à la place de ». Pour qui écrivez-vous ?
Quand j’écris, je n’ai pas la sensation d’écrire pour quelqu’un ou pour quelque chose. Tout se passe justement dans un grand vide, en direction de rien, donc de tout.
Vous êtes de moins en moins réels. Anthologie 2014-2021 et La Semaine perpétuelle, — ces deux titres évoquent les stigmates du temps : effacement pour l’un (et la datation qui suit dans le sous-titre renforce cet effet de disparition due au temps qui passe), permanence pour l’autre. En parlant du temps, je pense à ce qu’écrivait Henri Meschonnic dans La Rime et la vie : « [La poésie] est l’organisation dans le langage de ce qui a été réputé échapper au langage : la vie, le mouvement de ce qu’aucun mot n’est censé pouvoir dire. Et en effet les mots ne le disent pas. C’est pourquoi la poésie est un sens du temps plus que le sens dans les mots. » [9] Diriez-vous que votre poétique par expansion est une double tentative d’appréhender le temps dans ce qu’il a de plus insaisissable et de repousser les limites du fini de la langue vers un possible infini du langage ?
Oh non, je ne pense pas si loin. D’ailleurs quand j’écris, je ne pense pas. Je suis en train de suivre une impression qui dépasse l’ordre de mes pensées. Mais peut-être quelque chose pense par moments dans les phrases. Il y a une vibration, comme dans un organe, comme le battement du cœur d’un nourrisson, les pattes d’un insecte, il y a cette vibration dans l’ensemble des phrases et dans leur unité, c’est une vitalité, et parfois c’est une forme de pensée. Tout ça, je peux le voir et le travailler au moment de la relecture, plus tard. Je me relis et je me dis : tiens je n’ai pas écrit ça. Qui a écrit ça ? Moi je ne pouvais pas écrire ça, je ne savais pas écrire ça. Bien sûr, je ne sais pas écrire ça. Je n’ai pas écrit ça. Et sinon, je ne crois pas aux limites de la langue, car s’il en existe où sont-elles ? Je ne les ai jamais senties. Les mots ne substituent pas les objets auxquels ils renvoient par exemple, ils ont leur propre réalité, leur propre matière, c’est une autre dimension, très vaste, et dans mon expérience, sans limite, sans bords.
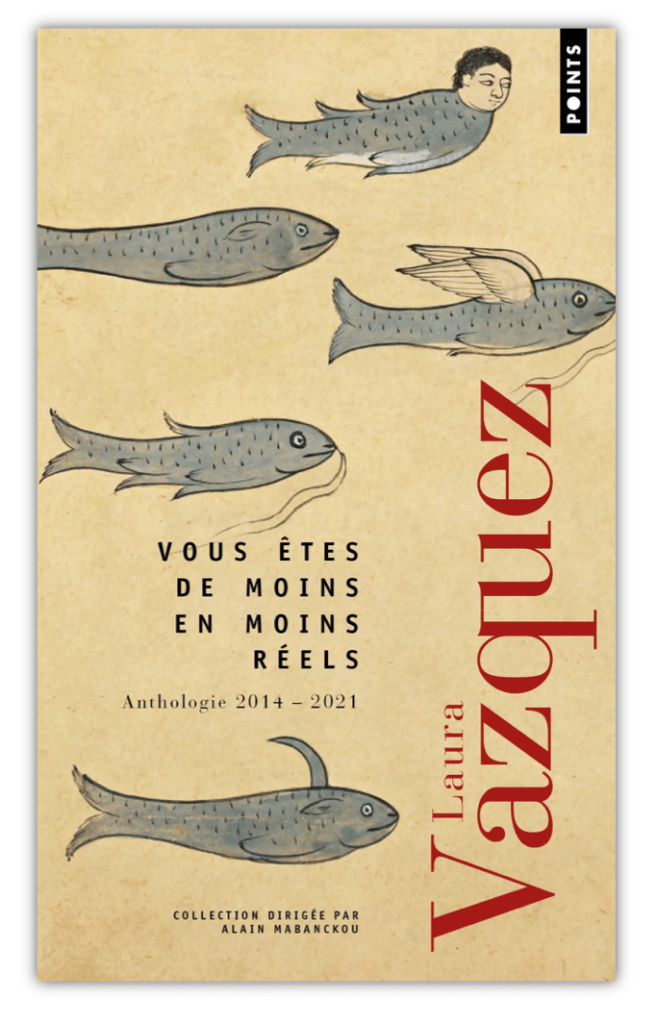
Dans Surgir (trad. Pascal Poyet, éditions de l’Attente, 2019), livre repris dans son anthologie Le Destin va ramener les étés sombres, parue aux éditions Points (en même temps que la vôtre), Etel Adnan clôt son ouvrage par ces mots : « Tout porte à croire que la poésie est l’espace dans lequel un objet et son autre territoire, ou le réel et la réalité, se rencontrent, de façon manifeste, pour que le réel passe dans la réalité et que la réalité soit le réel. » Ce texte m’a rappelé le titre de votre anthologie, mais c’est surtout cette idée de lieu qui m’intéresse ici. De quoi la poésie est-elle pour vous le lieu ?
Je sais pas. C’est un mystère que je ne comprends pas, mais j’ai l’impression que ce mystère me comprend très bien. Parfois, je peux le sentir ou le toucher. Quand j’écris, je dis toujours oui, c’est-à-dire je ressens un oui. Parfois, le texte aussi dit oui, alors il se passe cette chose : la personne individuelle disparaît, il n’y a plus de place pour elle, car il y a trop de place pour elle. C’est ce que je ressens. Ensuite, plus tard, je relis et il n’y a que des phrases. J’ai ressenti si fort, mais à la fin il n’y a que des phrases. Il n’y a qu’un livre avec sa couverture, son titre, et je ne serai pas à la hauteur de ce que j’ai voulu faire, car ce que je voulais faire était ce que je ressentais et ce que je ressentais n’avait pas une forme ou une limite.
En vous posant la question du lieu, je pense également à celles et ceux qui l’occupent, car votre pratique de la poésie n’est, à mon sens, pas exclusivement solitaire. Et si vous utilisez souvent le « je » dans vos poèmes, celui-ci ne me semble pas plus se rapporter à vous que le « il » ou le « elle », mais plutôt faire partie de ce « on », neutre, non-genré, presque anonyme dont je parlais plus haut. Vous co-dirigez avec Roxana Hashemi la revue Muscle, — revue sur laquelle je reviendrai —, mais je voulais préalablement aborder avec vous cette notion du « nous » en poésie, car j’ai l’impression que pour vous la poésie est moins un exercice solitaire qu’une véritable pratique collective. Une polyphonie. Je me trompe ?
Oui, c’est solitaire, ou alors avec des morts, des mortes, avec la fréquentation de morts, des mortes, mais si on ne les compte pas, c’est solitaire à 100 %, même s’il y a des voix bien sûr, et qu’elles se répondent ou s’ignorent, mais tout se passe dans cette zone ultra-silencieuse.
À côté de l’écriture, j’ai des activités non-solitaires, heureusement. J’aime bien par exemple essayer des textes avec des musiciennes, des autrices, des amies, faire des chansons, de la musique, des lectures à deux, c’est plus léger. Là, cette année, j’ai quelques essais en cours, des pièces sonores avec la compositrice Sivan Eldar qu’on présentera au centre Pompidou en juin, des discussions écrites avec Élodie Petit qu’on publiera dans un ouvrage collectif, une idée de texte à quatre mains avec Frédérique Soumagne, tout ça c’est surtout du temps avec des amies, mais voilà, tranquille, ça prend pas trop de place et ça me donne de l’air.
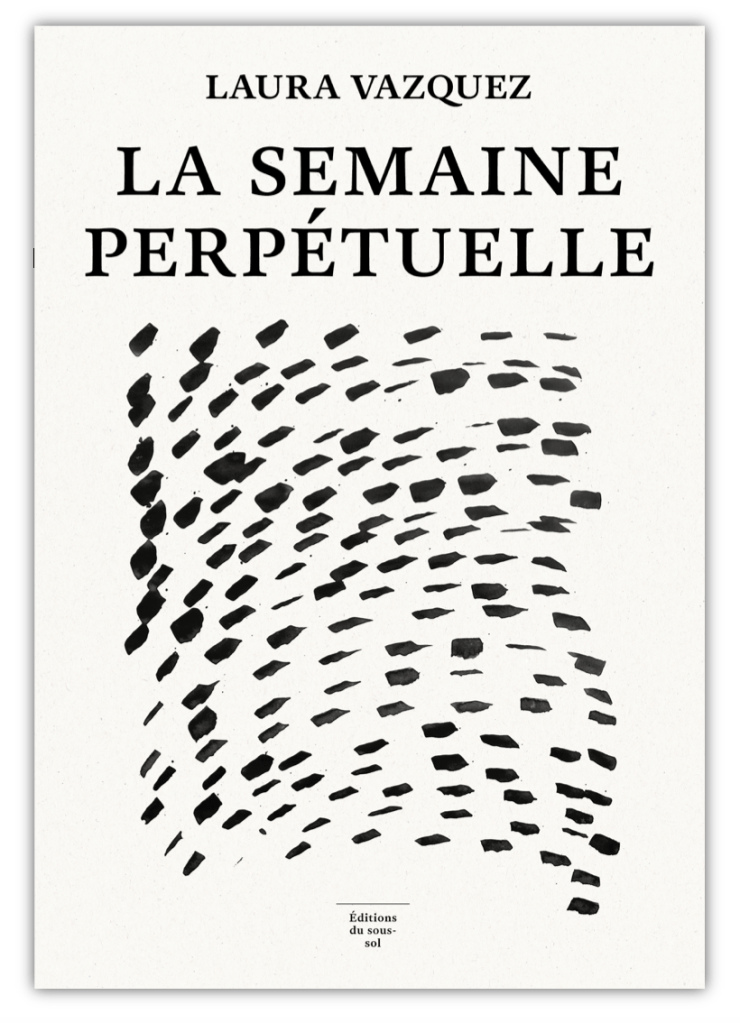
Vous disiez plus haut que pour vous les mots ne se substituent pas aux objets auxquels ils renvoient, qu’ils ont « leur propre réalité, leur propre matière », et qu’il s’agit là d’« une autre dimension, très vaste, dans [votre] expérience, sans limite ». On pourrait songer à la plus célèbre proposition du Tractatus logico-philosophicus de Wittgenstein, à savoir « Les limites de mon langage signifient les limites de mon monde » [10] ; mais c’est à une autre proposition de ce livre que je pense : « La logique n’est pas une théorie, mais l’image en miroir du monde. La logique est transcendantale » [11] (C’est moi qui souligne). Ce que vous dites de la matérialité du langage, de son rapport à la réalité, me fait penser à l’une des propriétés (au sens mathématique) de votre poétique : la réflexibilité. Dans votre écriture spéculaire, le mot ne se trouve pas simplement dupliqué : il s’y reflète en lui-même. Ainsi en est-il de « la main de la main », comme si le mot pouvait n’avoir d’autre image que lui-même. Diriez-vous qu’une des clés de votre processus créatif est liée à cette approche logico-poétique du monde comme absence de représentation ?
Je n’ai pas de théorie à propos de ce que je fais, j’ai des impressions, des intuitions, et je les suis. C’est comme si j’avançais dans la brume. Je ne sais pas ce que je vais faire et les choses se font.
Dans un entretien que vous avez accordé au magazine Le Matricule des anges [12], vous dites être « attentive à ce que font les auteurs et les autrices de [votre] temps et surtout des temps passés ». Dans ce même entretien, vous citez notamment Proust, Faulkner, Tolstoï, mais aussi Homère, Thucydide, ou encore Lucrèce. Votre nouveau livre, Le Livre du large et du long est une épopée. Doit-on voir dans ce geste d’écriture une sorte de reboot de la littérature ?
J’ai dit que j’étais attentive à ce qu’ont fait les auteurs que tu cites ? Je me suis trompée de mot. Je suis obsédée et je ressens du désir, c’est différent.
Je ne cherche pas à renouveler un genre. Bien sûr, je veux que l’écriture soit fraîche, qu’elle soit super vivante, mais les choses viennent comme elles viennent. Je n’ai jamais eu l’intention d’écrire une épopée. Il se trouve que pendant quelques années, j’ai écrit des poèmes et tous étaient portés par la même voix, celle de la même narratrice. À force de fréquenter cette voix, j’ai vu que c’était une fille et j’ai vu qu’elle vivait dans le mouvement caractéristique de l’épopée qui est : ALLER. Elle cherche, et en cherchant, elle va. Et avec tant d’intensité que je n’ai pas été loin de perdre la boule vers la fin, ça n’allait pas du tout. J’ai terminé ce livre la veille de mon départ pour Rome. Et quand je suis arrivée à la Villa Médicis, j’étais une sorte de zombie fragile vide triste. J’ai mis des mois à me remettre de ça.
Vous êtes en effet pensionnaire de la Villa Médicis pour l’année 2022-2023. Vous avez également bénéficié par le passé de plusieurs programmes de résidence, notamment celui de la Fondation Michalski en 2017, la résidence de la maison de la poésie de Rennes en 2019, ou encore celle de l’Association d’actions littéraires La Marelle [13], à Marseille, en 2020 et 2021. Pensez-vous que ces lieux privilégiés de création, ainsi que les bourses d’aide à l’écriture comme celle du CNL, sont aujourd’hui indispensables à l’exercice du métier d’écrivain·e ?
Non.
Vous proposez chaque semaine un atelier d’écriture en ligne, gratuit et accessible à toutes et à tous. Vous avez d’ailleurs créé pour ces ateliers un groupe privé, que vous animez sur le réseau social facebook, et qui regroupe près de 1 400 personnes [14]. Alors que certain·es écrivain·es connu·es proposent des masterclasses payantes (et parfois très lucratives), en quoi est-ce important pour vous d’animer ces ateliers gratuits ouverts au plus grand nombre ?
C’est une habitude que j’ai commencé à prendre pendant le premier confinement. Avant ça, j’ai donné pas mal d’ateliers, de workshops, à l’université, dans des écoles d’art, des collèges, lycées, en prison, dans des centres sociaux… Quand j’ai commencé mes ateliers sur internet, j’ai voulu que tout le monde puisse y accéder. Ce sont de petits exercices simples et hebdomadaires. C’est une bonne chose et un plaisir.
J’aimerais maintenant que nous parlions du Livre du large et du long dont vous avez enregistré une lecture intégrale. Vous accordez une place importante à la lecture à voix haute dans votre approche de la poésie, en organisant notamment des soirées de lectures à l’occasion de la parution de chaque nouveau numéro de la revue Muscle. Avez-vous travaillé ou retravaillé Le Livre du large et du long à l’oreille, par et pour la voix ?
Je n’ai pas eu besoin de lire le texte à voix haute pour l’entendre. Ça s’est fait dans la tête, par l’oreille intérieure. Et j’ai seulement suivi le rythme du texte, c’est lui qui décide du nombre de syllabes, de la place de tel ou tel mot, des retours à la ligne, de l’isolement de certaines séquences, du sens général, il n’y a pas de doute. J’ai juste suivi.
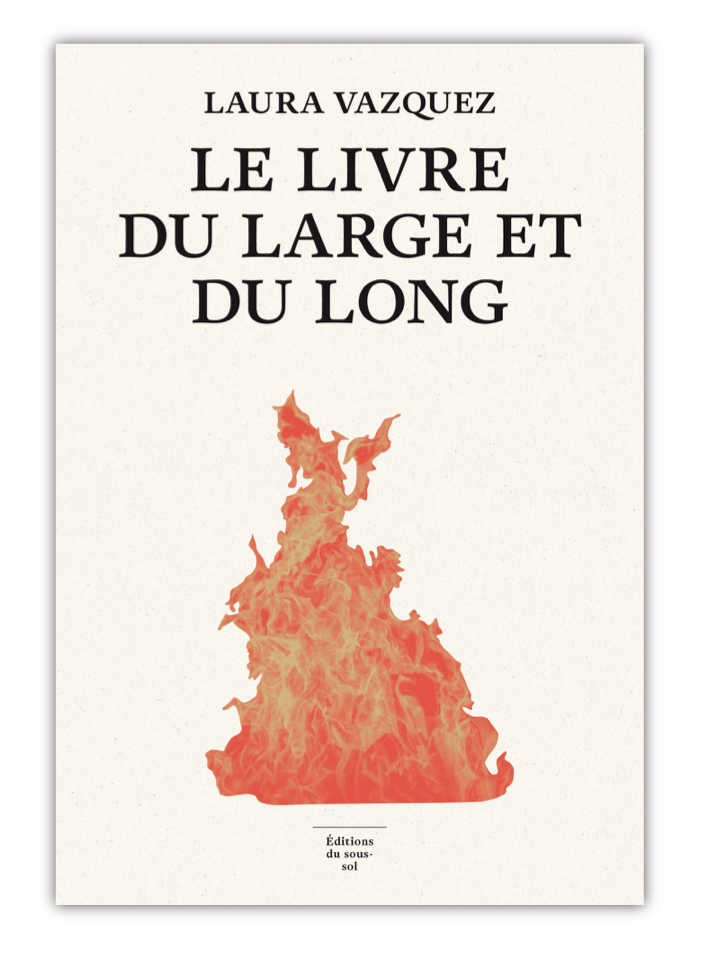
Le geste d’écriture à l’œuvre dans votre poème Le Livre du large et du long est épique en ce sens que sa puissance excède la forme qu’il redéfinit. On sent, en vous lisant, ce mouvement acharné d’épuisement de la forme, cette lutte chorégraphiée du texte avec vous-même. Vous relisez-vous, comme le dit Zadie Smith, jusqu’à l’usure ? Avez-vous retravaillé sans fin votre vers, ou avez-vous privilégié le souffle, l’énergie de la langue ?
Heureusement, les deux ne s’opposent pas, mais en général, quand j’écris un livre, il y a deux grandes phases : l’écriture et la correction. La seconde phase est bien plus longue que la première, environ dix fois plus longue.
Je parle de lutte, et j’ai eu cette impression en lecture, notamment dans le quatrième livre, que vous aviez laissé apparaître dans le texte les blessures de ce combat, tout ce qui a été supprimé, les vers fantômes, en maintenant de larges espaces blancs, plusieurs pages ne comprenant qu’un seul vers. « J’aurai toutes sortes de blessures », prévenez-vous d’ailleurs dans l’ouverture (p. 14). Avez-vous procédé essentiellement par soustraction ? Et avez-vous conservé les différentes versions de votre poème ? Gardez-vous vos brouillons, vos notes, en pensant à d’éventuelles archives ?
Je suis partie d’un grand ensemble d’environ 400 pages qui étaient des poèmes, des phrases isolées, des flots longs, des mots seuls, une grande chose emmêlée. Et j’ai cherché dans cette masse ce qui semblait sûr donc juste, les bonnes graines. À partir de ces éléments, j’ai tout réécrit. Et le texte a fait un peu plus de 700 pages. Là-dedans, j’ai taillé, enlevé tout ce qui ne participait pas à la vitalité de l’ensemble. Et il est resté environ 400 pages. Mais je ne sais pas comment les choses se font. C’est mystérieux. Et ça change presque entièrement d’un livre à l’autre. Et pour les chutes, les copeaux, en général je n’en garde pas beaucoup. Je garde seulement ce qui pourrait faire naître autre chose, donc une phrase, une proposition, une construction syntaxique, une image, un mot. Disons les bonnes graines vigoureuses.
Lorsque vous êtes parvenue à cet ensemble de quatre cents pages, à quel moment avez-vous su que le livre était terminé ?
Ça ne s’explique pas. J’ai senti que c’était fini. J’ai fait le chemin relecture-réécriture et relecture-réécriture des dizaines de fois, et puis au bout d’un moment, tout a été à sa place. Et là, il ne faut pas se prendre pour une créatrice de la vie en poussant, en inclinant les choses, seulement il faut les laisser, avec un sentiment d’échec, c’est une loi.
Valérie Zenatti dit dans un entretien que « l’écriture est d’abord un état dans lequel on se met ». En a-t-il été de même pour vous ? Avez-vous eu besoin d’atteindre un certain état pour écrire cette épopée ?
Oui, c’est un état. C’est même un état physique. J’étais dans un certain état. Quelque chose grillait en moi.
En 2019, le magazine Les Inrockuptibles consacrait un article aux « dix poètes nouvelle génération à suivre sur les réseaux sociaux » [15] dont vous faisiez partie, aux côtés de Rim Battal, Rupi Kaur ou encore Koleka Putuma. Maxime Actis, Amandine André, Vanessa Bell, Katia Bouchoueva, Sara Bourre, Jean D’Amérique, Kim Doré, Annie Lafleur, A.C. Hello, Maud Joiret, Anne Kawala, Julia Lepère, Laura Lutard, Miel Pagès, Élodie Petit, Maude Pilon, Marie de Quatrebarbes, Nathanaëlle Quoirez, Marine Riguet, Marina Skalova, Olivia Tapiero, Milène Tournier, Maude Veilleux… je pourrais continuer à dresser une longue liste de poètes et de poétesses né·e·s comme vous à la fin des années 1980 ou au début des années 1990. Avez-vous le sentiment d’appartenir à une même génération de poètes et de poétesses ? Quelles sont vos lectures favorites dans le champ poétique actuel et quelles influences littéraires vous reconnaissez-vous ?
Oui, c’est très bien, il y a des personnes qui me sont proches parmi les noms que tu cites. On vit au même moment, dans la même période, dans les mêmes paroles, et c’est là qu’on écrit, mais je passe surtout beaucoup de temps avec les mortes et les morts. Je m’intéresse pas mal aux retraductions aussi et à la poésie d’autres langues, aux chansons, aux commentaires sur internet, aux textes sacrés.
Vous animez avec votre compagne Roxana Hashemi la revue de poésie Muscle [6] créée en 2014. En quoi est-ce important pour vous de mener ce travail de publication en revue de textes de poètes et de poétesses ?
Ça nous plait bien, on essaie d’aider ce qui existe, c’est très varié ce qu’on publie.

Quelle lectrice êtes-vous ? Lisez-vous des livres en lien avec vos travaux en cours ? Parmi les livres que vous avez lus récemment quels sont ceux qui vous ont particulièrement marquée ?
En général je lis avec le désir de trouver, il y a une sorte d’avidité dont je ne me défais pas. Je ne viens pas du tout d’une famille lettrée ; donc j’ai souvent eu l’impression d’avoir du retard et de devoir lire énormément. Mais surtout, je cherche quelque chose pour le livre en train de s’écrire. J’ai l’impression que je vais trouver une idée, un mouvement, qui va ouvrir mon texte, lui donner de la puissance, de l’exactitude, de la netteté dans ses détails. Donc mes lectures sont très précises, ciblées, je fais très attention. Comme une médecine, je me prescris des livres en fonction de l’état. J’essaie de ne pas blesser quelque chose en moi qui existe pour le livre en train de se faire. Je lis rarement les livres qu’on me recommande, parce que je suis lancée dans un truc déjà. En ce moment par exemple, je lis des traités d’agronomie, les agronomes latins, Caton, Varron, Columelle, Palladius, le vocabulaire est extraordinaire, c’est très pratique, matériel, concret. Et puis je relis un peu Inger Christensen, Kim Hyesoon, Lao Zi. Dernièrement, j’ai lu Précieuse guirlande de la Loi des Oiseaux, traduit du tibétain par Henriette Meyer, c’est un texte qui m’a donné des idées.
Pour conclure cet entretien, pouvez-vous nous dire quelques mots de la tragédie lesbienne sur laquelle vous travaillez à la Villa Médicis ? S’agit-il d’une pièce conçue pour le livre ou est-ce un texte destiné à la scène ?
Pour l’instant, je ne comprends rien à ce que je fais, et c’est une bonne chose.
C’est un texte qui sera joué. Il est fait pour vivre sur scène. C’est du théâtre.
Mais j’aimerais qu’il soit publié, il saura exister sous forme de livre. C’est un livre.
J’ai envie de travailler pour le théâtre encore. Je n’ai pas terminé. Dans le théâtre, il y a une intensité et une puissance qui se fait par l’expérience. J’ai quelques débuts de projets en cours, notamment avec Philippe Quesne qui a déjà mis en scène des extraits de mes poèmes, et avec Lorraine de Sagazan, qui est aussi pensionnaire à la Villa cette année.
Entretien réalisé par courrier électronique de janvier à mars 2023. Propos recueillis par Guillaume Richez. Photographies de Laura Vazquez, Villa Médicis, Rome, février 2023 © Élise Blotière.
[1] « Elle ne parlait plus bien l’espagnol ; elle ne parlait pas le français. Ça donnait une sorte de protolangue assez belle et inventive, mais seuls ses enfants pouvaient la comprendre. » Entretien avec Laura Vazquez, in Le Matricule des anges, n°241, mars 2023, pp. 15-16.
[2] « J’écrivais mal, je le savais, j’en pleurais de rage. » (Ibid., p. 17)
[5] https://www.weekendpoetry.com/
[7] https://chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/2021/11/10/la-semaine-perpetuelle-de-laura-vazquez/
[8] https://chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/2022/09/16/contre-mesures-3/
[9] Henri Meschonnic, La Rime et la vie, coll. Folio essais, Gallimard, 2006, p. 247.
[10] Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philisophicus, trad. par Christiane Chauviré et Sabine Plaud, collection GF, Flammarion, 2022, p. 194.
[11] Ibid., p. 210.
[12] N°232, avril 2022, p. 43.
[13] https://www.la-marelle.org/
[14] https://www.facebook.com/groups/atelierdecriturelauravazquez/
2 réflexions sur “Entretien avec Laura Vazquez”